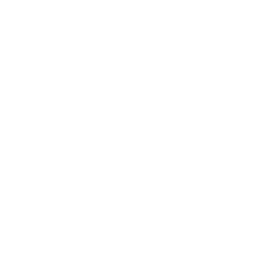
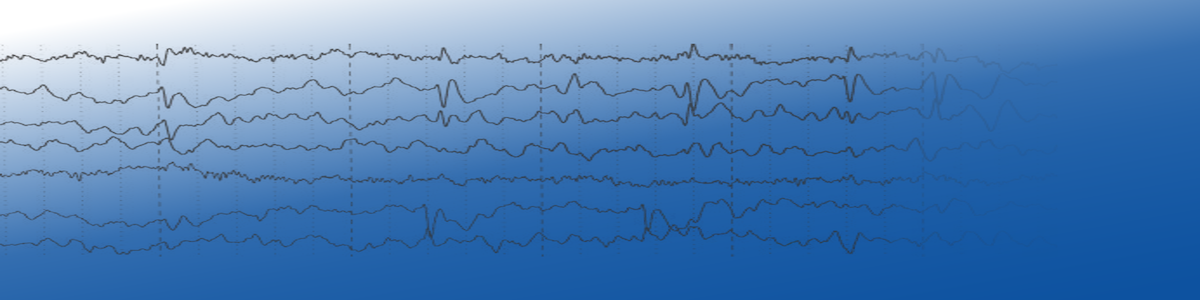
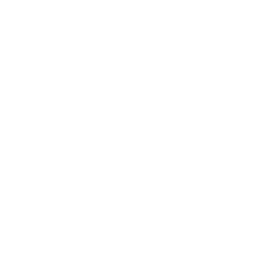
Au cours du XXe siècle, mathématiciens et physiologistes se sont interrogés sur la possibilité d’inventer des machines capables d’affronter, d’assister, voire de remplacer l’intelligence humaine. A l’aube du XXIe siècle, ce domaine, désormais appelé Intelligence Artificielle (IA), a prospéré parallèlement à l’essor de l’informatique ; il est littéralement en train d’exploser ces dernières années. Les neurosciences jouent un rôle de premier plan dans la création d’IA capables d’imiter les habiletés humaines. C’est ce que nous avons souhaité montrer dans ce dossier à l’aide de quelques exemples.
Camille Jeunet-Kelway et Emeline Pierrieau définissent les notions liées au neurofeedback (NF). En établissant les relations causales entre activité cérébrale et comportement, le NF aidé par les méthodes de traitement du signal et l’IA, permet d’améliorer les interfaces cerveau-ordinateur. Il est également utilisé comme outil d’optimisation des performances cognitives tant chez les sujets sains que chez des patients présentant des altérations. Emanuelle Reynaud nous projette dans un monde digne de la science-fiction en nous décrivant les interfaces cerveau-machines. Portées par les neurosciences et l’IA, ces interfaces pourraient repousser les limites de nos capacités naturelles permettant de contrôler des machines par la pensée. Toutefois, ces technologies soulèvent des questions sociétales et étiques que les autrices de ces 2 articles abordent. Le texte de Rufin VanRullen explore les fondements de l’IA et montre comment les neurosciences peuvent être utiles pour lier le fonctionnement des systèmes artificiels à celui du cerveau humain. Les trois articles suivants expliquent comment les interfaces cerveau-ordinateur ou cerveau-machine peuvent contribuer à la réparation du vivant lorsqu’il a été endommagé. Les contributions de Fabien Wagner puis de Guillaume Charvet et collaborateurs, montrent comment l’IA permet de décoder les intentions motrices à partir des signaux cérébraux. L’algorithme d’IA présentée par F. Wagner est ainsi utilisé pour stimuler la moelle épinière et faciliter le mouvement décodé de la flexion de la hanche, du genou et de la cheville. De façon similaire, G. Charvet et collaborateurs., décrivent une technologie d’interface cerveau-machine permettant, par exemple, de contrôler un exosquelette chez les patients tétraplégiques. Lorsqu’un membre est absent, peut-il être remplacé par un membre artificiel ? Aymar de Rugy répond à cette question en nous montrant comment les dispositifs en cours de développement permettent de contrôler un bras robotisé avec la même précision qu’un membre naturel. Dans le domaine de la neuro-imagerie, Antoine Bourlier et collaborateurs expliquent comment l’IA pourrait permettre d’analyser les images d’IRM cérébrales sans prérequis anatomiques. Cette méthode reposant uniquement sur les informations contenues dans l’image, permettra d’enrichir nos connaissances neuroanatomiques sur toutes sortes d’espèces animales. Notez que cette méthode est mise à disposition sur une plateforme dédiée. La bio-inspiration est évoquée dans plusieurs textes de ce dossier. Le comportement complexe des colonies de fourmis ou de termites fondé sur l’intelligence collective est ainsi une source d’inspiration pour le développement de l’IA. C’est ce comportement que nous décrit le texte de Guy Theraulaz.
Nous voyons ainsi que les neurosciences jouent un double rôle dans le développement de l’IA : elles sont à la fois la source et l’un des principaux bénéficiaires. N’oublions pas les enjeux éthiques que soulève l’IA. Bien qu’évoqués dans certaines contributions de ce dossier, ces questionnements restent centraux et seront abordés dans un prochain numéro.







